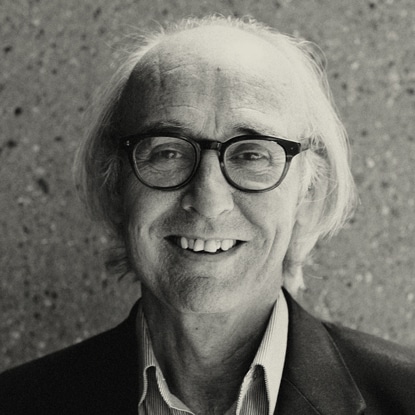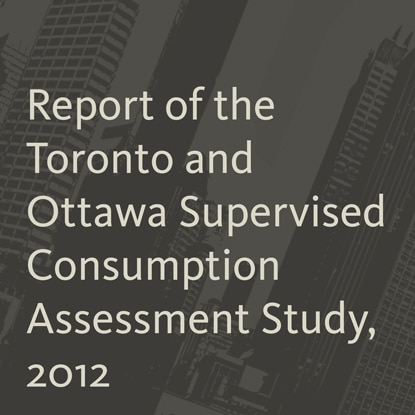Les trois derniers mois ont foisonné d’activités comme nous établissons davantage notre présence comme CCPD et formons des liens avec des organisations et des personnes du pays et du monde entier. Il se produit véritablement quelque chose de grand, et un élan se dirige vers de nouvelles approches innovatrices pour aborder les problèmes de drogues.
En février, j’ai été invité à prendre la parole à un congrès international, à Mexico,Drogas : Un balance a un siglo de su prohibición, organisé par le groupe de prévention du crime Mexico Unido Contra la Delincuencia. Le forum a effectué un examen exhaustif des solutions de rechange possibles aux conséquences désastreuses de la guerre aux drogues du gouvernement mexicain. Des conférenciers sont venus du monde entier pour faire part de leurs innovations, de leurs changements législatifs et de leurs pratiques qui ont donné aux politiques des drogues une approche de santé publique et les ont éloignées du modèle de justice pénale raté.
Intégration de l’injection supervisée dans les services de santé et la communauté : un échange de connaissances national
En avril, la CCPD a organisé un forum sur les services d’injection supervisée en partenariat avec le centre du Dr Peter de Vancouver et Cactus Montréal, à titre de réunion connexe du congrès de l’Association canadienne de recherche sur le VIH, à Montréal. Le congrès avait lieu à la magnifique Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C’était une occasion pour les organisations de partager leurs expériences et de vérifier l’état actuel des discussions dans leurs localités. La CCPD travaille avec un certain nombre d’organisations à faire avancer ces discussions tandis que différentes localités cherchent à mettre en œuvre ces services.
Rencontre de la stratégie nord-américaine sur les drogues – San Francisco, 12 et 13 avril
Dans le cadre du travail international de la CCPD, nous avons été l’hôte d’une rencontre conjointement avec la Drug Policy Alliance des États-Unis et CUPHID de Mexico afin d’explorer le développement d’un dialogue coordonné nord-américain à propos des politiques sur les drogues. La rencontre de San Francisco a été la première séance préliminaire dans le but de vérifier comment nous pouvons collaborer à proposer des solutions de rechange aux politiques sur les drogues actuelles en Amérique du Nord. Tentant de raffermir ses liens sur le continent, la CCPD recherche présentement des alliés canadiens intéressés à soutenir ses travaux au Mexique.
Visite dans les Maritimes
Conformément à notre projet de constituer une coalition nationale, j’ai visité le Canada atlantique en mai. J’ai assisté à des activités et des rencontres à Halifax, à Saint-Jean Nouveau-Brunswick et à Charlottetown. Le Réseau atlantique de recherche sur la réduction des méfaits a invité la CCPD à prendre part à sa séance publique – Les gens et les politiques : comment les politiques sur les drogues influencent-elles la santé de nos communautés? En outre, une séance d’un jour avec des prestataires de services et des chercheurs examinait aussi comment mieux intégrer les services de réduction des méfaits dans le contexte des refuges et des salles d’urgence.
À Saint-Jean NB, AIDS Saint John, l’institut des études urbaines et communautaires de l’Université du Nouveau-Brunswick et la CCPD ont co-organisé une activité, Les drogues et la ville, qui présentait une discussion d’experts en politiques sur les drogues avec Tim Christie, directeur de l’éthique, région sanitaire de Saint-Jean et Bill Reid, chef du service de police de Saint-Jean.
À Charlottetown, j’ai rencontré des parents inquiets de l’absence de traitements pour les jeunes dans l’île, qui sont intéressés à organiser un « mouvement des toxicomanies » provincial afin de stimuler la discussion, de partager des expériences et de faire participer le gouvernement provincial au dialogue sur l’amélioration des services pour les personnes aux prises avec des problèmes de drogue.
Stratégie municipale sur les drogues de Thunder Bay
Le 24 mai, Canadian Students for Sensible Drug Policy et la stratégie sur les drogues de Thunder Bay ont organisé l’activité Pot, Pills and Parties, qui portait sur l’effet du projet de loi C-10 sur les jeunes gens et comprenait une présentation de la CCPD :Changer le cadre : une nouvelle approche des politiques sur les drogues au Canada.
En joignant les gens à travers le pays, la CCPD trouve de nouvelles façons innovatrices de consolider et de constituer sa coalition afin d’améliorer l’approche du Canada relativement aux problèmes des drogues. Nous continuerons de mobiliser les Canadiens et de travailler à cette fin à l’échelle internationale.
Photo Credits:
Mexico – Steve Rolles
Montréal – Caroline Mousseau
San Fransisco – CC Flickr evoo73
Halifax – Wooden Shoe Photography