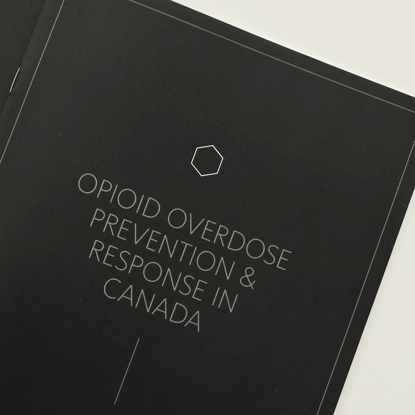Il s’agit du deuxième d’une série de trois articles consacrés à l’importance d’envisager une réforme des politiques et des programmes en vigueur dans les prisons fédérales canadiennes. Vous pouvez consulter le premier article ici.
 Lorsqu’il s’agit de médicaments en milieu carcéral, les agents correctionnels canadiens se préoccupent d’abord de ne pas laisser entrer les drogues illégales dans les prisons. Par conséquent, une attention insuffisante est accordée à la consommation et à l’accès, en milieu carcéral, aux médicaments psychotropes prescrits pour soigner les affections physiques ou mentales. Cette négligence crée des lacunes de connaissances ayant une incidence négative sur la santé et le bien-être des prisonniers. De plus amples études et une amélioration des politiques régissant l’accès des prisonniers aux médicaments s’imposent de toute urgence.
Lorsqu’il s’agit de médicaments en milieu carcéral, les agents correctionnels canadiens se préoccupent d’abord de ne pas laisser entrer les drogues illégales dans les prisons. Par conséquent, une attention insuffisante est accordée à la consommation et à l’accès, en milieu carcéral, aux médicaments psychotropes prescrits pour soigner les affections physiques ou mentales. Cette négligence crée des lacunes de connaissances ayant une incidence négative sur la santé et le bien-être des prisonniers. De plus amples études et une amélioration des politiques régissant l’accès des prisonniers aux médicaments s’imposent de toute urgence.
Voici un aperçu du contexte : Les services de santé dans les prisons fédérales doivent être dispensés conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui stipule que chaque détenu recevra les « soins de santé essentiels » et aura un « accès raisonnable aux soins de santé mentale non essentiels » qui contribueront à sa réadaptation et au succès de sa réinsertion dans la collectivité. Le Service correctionnel du Canada (SCC) a instauré une Directive du Commissaire ainsi que plusieurs autres directives et procédures en ce qui concerne l’administration de médicaments, y compris un Formulaire national auquel toutes les prisons fédérales doivent se conformer. Le formulaire explique en détail aux médecins, pharmaciens, et personnel soignant, quels médicaments sont admissibles en milieu carcéral. Plusieurs médicaments psychotropes sont exclus du formulaire parce qu’ils présentent un risque élevé de mauvaise utilisation ou de détournement (p. ex. les détenus pourraient vendre leurs médicaments, ou être victimes d’intimidation de la part d’individus voulant acquérir leurs médicaments). Les substances psychoactives figurant au formulaire font l’objet de restrictions précises (p. ex., elles ne peuvent être prescrites que dans certaines circonstances, ne peuvent être administrées pendant plus d’une semaine, doivent être prises sous observation directe, etc…). En dépit des règles et règlements en vigueur, les employés d’organismes externes, ainsi que les anciens employés du SCC, signalent que des politiques plus claires et des pratiques améliorées s’imposent.
Les individus admis dans le réseau carcéral sont généralement perturbés dès leur arrivée. Les médicaments qui leur étaient administrés lorsqu’ils faisaient partie de la collectivité leur sont refusés, totalement ou progressivement. Plusieurs facteurs, y compris le manque de communication entre les prestataires de soins de santé et le personnel de sécurité, le respect scrupuleux du formulaire, ou les changements apportés à ce dernier, peuvent contribuer à prolonger le délai qui s’écoulerait avant qu’un détenu puisse reprendre ou commencer un traitement. Il est clair qu’une telle situation provoque des répercussions sur la santé mentale et / ou physique d’un détenu.
Les observateurs du système et les anciens employés du SCC relatent les expériences de détenus aux prises avec de graves symptômes psychologiques, auxquels des transfèrements ont été imposés avant qu’ils ne puissent recevoir les médicaments appropriés. Pour soulager la douleur, les praticiens exerçant en milieu carcéral éprouvent des difficultés lorsqu’il prescrivent les quelques médicaments contre la douleur figurant au formulaire. Dans certains cas, l’administration de médicaments contre la douleur, auxquels les détenus avaient accès pendant plusieurs années avant leur incarcération, est interrompue. Les détenus ont parfois la possibilité de consulter des spécialistes du traitement de la douleur travaillant en milieu communautaire, et ces derniers peuvent formuler des recommandations en ce qui concerne les soins de santé administrés en milieu carcéral, mais de telles occasions ne se présentent pas nécessairement en temps opportun, ou de façon uniforme. Des exceptions au formulaire peuvent à l’occasion être accordées, mais il s’agit d’un processus incertain sans aucune garantie. La politique de tolérance zéro régnant dans les prisons fédérales ne facilite en rien cette situation. Les détenus présentant une demande de médicaments psychoactifs pour traiter la douleur ou toute autre affection sont souvent considérés comme des « toxicophiles » et attirent donc les soupçons.
Il convient de souligner que certains groupes sont plus susceptibles de se faire prescrire ou de prendre des médicaments psychotropes (le plus souvent sous la forme d’automédication) et sont donc touchés de façon disproportionnée par l’absence d’accès aux médicaments en temps opportun. Ces groupes incluent : les détenus atteints de problèmes de santé mentale et ceux souffrant de traumatismes psychologiques; les femmes prisonnières, plus particulièrement celles issues de milieu autochtone; les détenus éprouvant une douleur physique chronique, y compris les personnes atteintes de VIH qui souffrent de neuropathie périphérique douloureuse, ainsi que les prisonniers âgés ou vieillissants. Le Bureau de l’Enquêteur correctionnel reconnait depuis longtemps le besoin de mieux répondre aux besoins des prisonniers en matière de santé physique et mentale, y compris l’accès aux médicaments et a récemment indiqué que 63% des femmes détenues dans les prisons fédérales reçoivent des médicament psychotropes pour traiter les symptômes de maladie mentale.
Pour garantir l’accès des détenus aux « soins de santé essentiels » auxquels ils ont droit, ceux et celles d’entre nous qui sommes chercheurs, prestataires de services et défenseurs des soins de santé en milieu carcéral devons poursuivre cette question. Si nous voulons une société juste et humaine qui prend en considération la santé et le bien-être des détenus, il est nécessaire d’approfondir nos connaissances au sujet de l’accès aux médicaments en milieu carcéral.